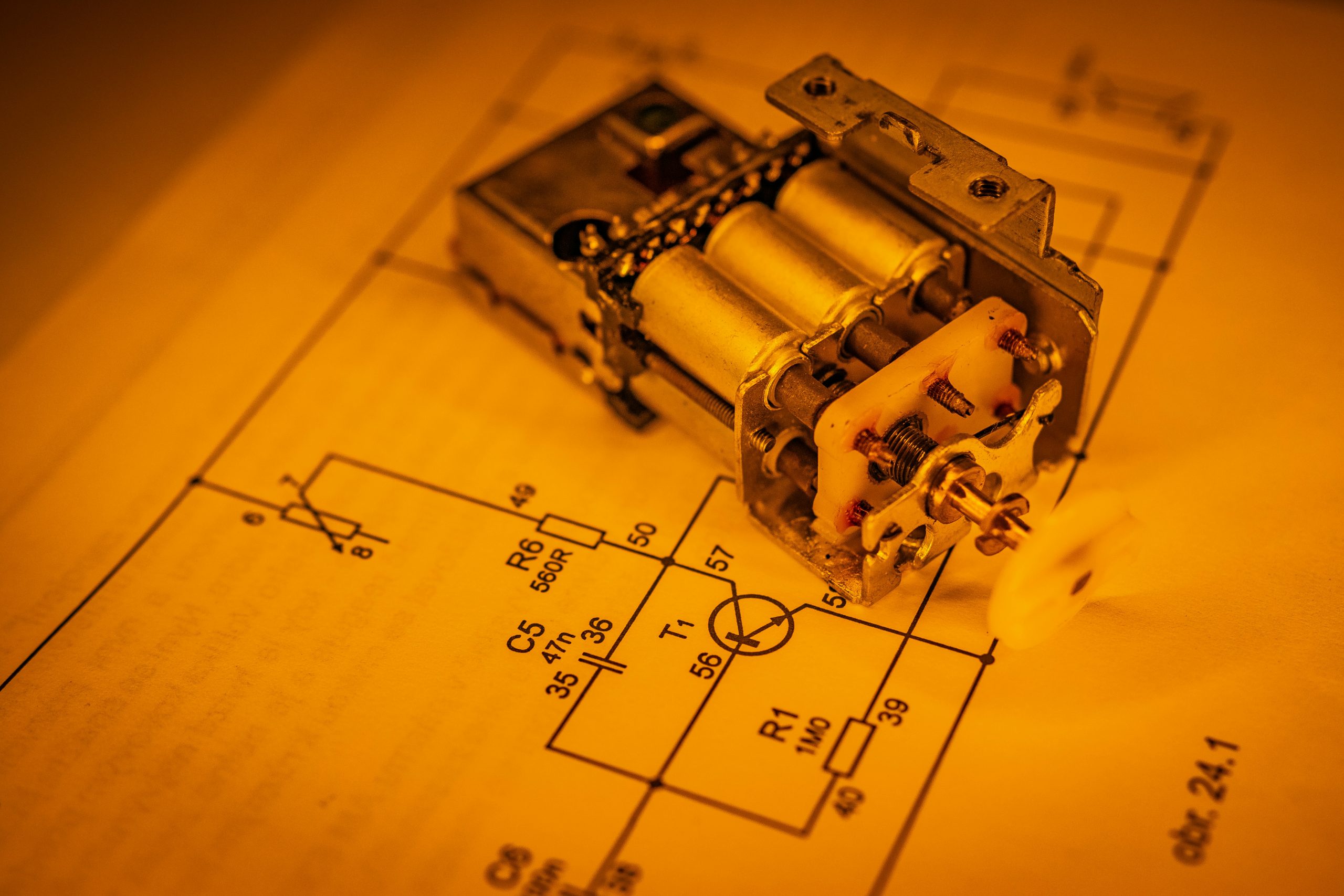“Encore ensablés au cœur de cette crise sanitaire sans précédent, nous sommes nombreux à nous interroger sur « l’après ».
En restant sur mon cœur de compétences, l’organisation, je vois une nécessité criante si l’on veut réussir à bâtir une société plus résiliente : ne plus opposer le fonctionnement en mode « crise » à une situation normale mais l’intégrer au quotidien.”
Jean-François Pirus, fondateur du cabinet BPMS et président du chapitre France de l’International Institute of Business Analysis (IIBA®), nous livre dans ce billet un plaidoyer vibrant pour un changement de fond “post-Covid-19”.
La gestion des risques n’est pas dans notre culture occidentale
Nous rechignons à anticiper le pire et – surtout – à nous y préparer. Ce constat qui vaut pour la France peut être étendu – avec quelques nuances près – à l’ensemble de l’Europe et à l’Amérique du Nord.
Et le constat – douloureux – que nous faisons en France dans le domaine de la santé est le même que celui que nous pouvons faire sur celui de l’écologie ou la dépendance économique : il faut attendre de vivre les conséquences des catastrophes pour commencer à s’en préoccuper.
Soucieux de l’efficacité de nos organisations, nous avons consacré toute notre énergie à optimiser notre mode de fonctionnement « hors crise ». La gestion des risques ? Confiée à des spécialistes (c’est déjà ça) chargés de bâtir des Plans de Continuité d’Activité, en cas d’empêchement majeur du système de production. Je ne m’étendrai pas sur la réalité et la précision – variables – de ces PCA qui ont souvent pour principal but de rassurer le management : « il y a un plan B ».
S’il y a une caractéristique commune à l’immense majorité de ces « plans B », c’est qu’ils se juxtaposent avec le mode de fonctionnement normal : censés répondre à une situation exceptionnelle, ils sont là pour permettre le passage – transitoire – du plan A ou plan B : la crise passée, il s’agit de revenir au « Business as usual ».
Quelles leçons pouvons-nous d’ores et déjà tirer de ce premier mois de confinement ?
Que le plan B – même quand il n’est pas préparé – est possible.
Mais qu’il n’est pas durable : les parents peuvent pallier temporairement la fermeture des écoles, l’Etat peut – au prix d’un endettement sur le temps long – subvenir un temps aux salaires non payés,…
La fin de l’exception ne pourra se résumer à un retour pur et simple à la situation d’avant.
D’abord parce que cela n’est pas souhaitable car cela reviendrait à ne pas tirer profit de tout ce que nous enseigne cette crise. Ensuite parce que nous n’avons pas le choix : il est plus que probable ces phénomènes de crise n’aient plus rien d’exceptionnel. Et qu’il ne suffira pas de s’être préparé à un type de crise particulier (ici sanitaire) pour être prêt à encaisser une crise d’un autre type. Imaginer simplement l’impact, non pas d’une pandémie, mais d’une instabilité – pour rester mesuré – durable de notre puissance électrique ou du réseau Internet. Fini la possibilité de s’appuyer sur le télétravail ou les ressources en ligne pour supporter l’isolement…
Se préparer au monde de demain, c’est apprendre à banaliser l’imprévu
On le sent intuitivement, nous n’allons pas pouvoir durablement fonctionner en mode alternatif : une période normale, une période de crise. C’est inefficace, épuisant psychologiquement et sans doute pas soutenable socialement et économiquement. Ce qu’il faut c’est apprendre à « banaliser la crise », la réduire à un simple ajustement du fonctionnement au quotidien : une sorte de variante prévue dans les grandes lignes qui permette de s’ajuster sans trop de difficultés aux conséquences prévisibles d’un événement imprévu.
En d’autres termes, plutôt que de passer du plan A au plan B, concevoir un plan « AB »
Quelques exemples :
Au sein de l’hôpital, on a pu souligner l’importance, dans la gestion de la crise sanitaire, d’avoir pu créer aussi rapidement 5000 lits de réanimation de plus. Cette transformation s’est faite « dans l’urgence » et la question du devenir de ces lits supplémentaires au terme de la crise se pose déjà. Le plan « AB » consisterait à concevoir des chambres ou des services polyvalents que l’on puisse basculer d’un usage à l’autre au gré des besoins.
Ce n’est pas le cas le plus complexe car le système hospitalier gère déjà, par exemple au niveau des blocs opératoires, une certaine agilité organisationnelle.
Le cas de l’éducation pose un autre défi : le passage à l’école à la maison n’a été possible qu’en s’appuyant sur des parents eux-mêmes confinés. Et malgré tout le dévouement des enseignants, cela n’est pas sans impact sur la continuité de l’apprentissage.
Un plan « AB » consisterait à intégrer ce mode d’enseignement à distance dans le cursus pédagogique normal, par exemple 1 jour par semaine, pour que la survenance d’une « crise » soit simplement un curseur à pousser, pas un changement complet d’outil et d’organisation. En fournissant une compensation financière au parent de garde, mais aussi en cherchant des solutions alternatives quand le domicile ne permet pas d’assurer la continuité pédagogique dans de bonnes conditions. Une rupture majeure de l’organisation de notre école encore très largement inspirée de celle de Jules Ferry. Mais une évolution qui, en obligeant à se réinventer totalement au niveau des supports pédagogiques, permettrait aussi de remotiver des élèves en échec.
Dans le monde du commerce, le plan B a consisté à éviter – même si c’était autorisé – de sortir tous les jours pour effectuer ses achats de première nécessité. Plutôt que de continuer à encourager la grande distribution à une ouverture 7/7 jours, le plan « AB » pourrait revenir à une journée hebdomadaire de fermeture (ce à quoi s’astreignent les petits commerces). Le développement du « clic & collect » (commander et aller chercher) permettrait à ces enseignes de concentrer leur activité sur un temps plus limité tout en évitant aux clients de devoir supporter à la fois promiscuité et files d’attente. Les impératifs de distanciation sociale pourraient se transformer en l’obligation de gérer l’affluence. Comme le fait déjà un musée pour garantir le confort de visite. On réserverait son créneau de visite du supermarché avec, comme dans les musées, un « sens de la visite ».
En matière de transport, certains maires de grandes villes réfléchissent à rendre plus régulières les « journées sans voiture ». Il y aurait aussi un véritable intérêt à décréter de manière permanente des créneaux sans camions, au moins pour le trafic de transit. En voyant tous ces poids lourds internationaux s’agglutiner aux heures de pointe avec les véhicules de particuliers, je me suis toujours demandé pourquoi l’Ile de France ne le faisait pas. Même le secteur de la logistique y gagnerait. Sans parler de qualité de l’air.
Dans le monde de l’entreprise ou l’administration, l’optimisation des processus a souvent consisté à automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, en acceptant d’instaurer de multiples liens de dépendance : de l’usager par rapport à son application dont il ne maîtrise plus les règles mais aussi de l’entreprise vis-à-vis de son fournisseur d’application. Bref en perdant le contrôle.
>> Lire aussi : Comment automatiser vos tâches à faible valeur ajoutée grâce à la RPA
Un responsable de la mise en place de « robots applicatifs » dans une grande banque indiquait que ces outils étaient tellement appréciés de ses clients que rapidement, ils ne se préoccupaient plus de vérifier ce que faisait le robot. Pour y remédier, il prônait le contrôle régulier du travail du robot mais doutait de la réalité de ce contrôle (un peu comme pour les PCA). Seule alternative à ses yeux : instaurer périodiquement une « journée sans robot » pour vérifier que l’on est toujours capable de s’en passer. Et accessoirement mesure dans la durée la valeur apportée par l’outil.
Application pratique aux outils du quotidien : l’équipe commerciale peut-elle gérer sa tournée si l’outil de CRM est indisponible ? La comptabilité assurer des paiements ou le service Achats passer des commandes même si l’outil central « à tout faire » est hors service ou trop complexe pour les intérimaires remplaçant les titulaires ? L’utilisateur connaît il les règles à appliquer quand le système d’information n’est pas là pour les contrôler ?
Le mode “dégradé” : une simple variante du mode de fonctionnement normal
Je pourrais multiplier les pistes de réflexion à l’infini et je n’ai pas la prétention d’apporter, dans ces illustrations, la solution la plus pertinente qui soit.
Mon propos est simplement de souligner que si hier, il s’agissait de réfléchir en parallèle à un fonctionnement nominal et un mode dégradé, demain, il s’agira d’intégrer ce mode dégradé comme une simple variante du fonctionnement normal.
Cela n’a l’air de rien, mais c’est un changement total de paradigme pour nous qui avons été habitués à vouloir (et souvent à obtenir) « tout pour tout de suite » et avons accepté de dépenser beaucoup d’énergie pour assurer la continuité d’un monde sans aléas…
Jean-François PIRUS
Cet article vous a plu? Partagez-le et suivez-moi sur les réseaux sociaux!